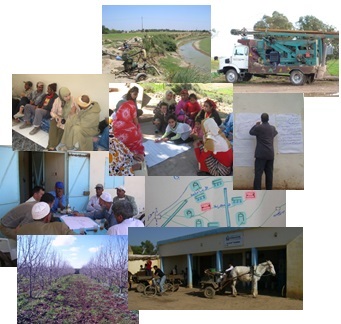Tarik Hartani, Mohamed Naouri, Marcel Kuper
DOI: https://doi.org/10.60569/hsjr-a6
Hors-série jeunes ruraux – juin 2015
Résumé
En Algérie, l’approvisionnement des marchés de gros en fruits et légumes dépend quasi exclusivement de la production locale. L’abondance et la régularité de ces productions constituent un enjeu important de sécurité alimentaire pour l’Etat qui doit assurer un approvisionnement suffisant des villes, en forte croissance démographique. La plaine des Ziban tout autour de la ville de Biskra connait une forte dynamique agricole. Située aux portes du Sahara, cette plaine se caractérise par de vastes étendues de terres, un climat aride et de nombreux points d’eau. Notre étude porte sur les trajectoires des nombreux jeunes algériens qui affluent dans cette plaine pour y trouver du travail, plus particulièrement pour cultiver le maraîchage sous serre. Débutant en tant qu’ouvriers ou métayers, ils arrivent à économiser et peuvent rapidement devenir métayers, locataires puis propriétaires. Leur projet correspond soit à un investissement à moyen terme dans l’activité agricole localement ou dans leur région d’origine soit à quitter l’agriculture. Nous nous interrogeons enfin sur la capacité des politiques publiques à intégrer ces nouveaux acteurs dans la profession agricole.
دخول الشباب في الفلاحة: نموذج المغطاة التسويقية الزراعات بالزيبان –الجزائر
بالجزائر، يتم تزويد الأسواق الكبيرة بالخضر والفواكه ،بشكل شبه حصري بالمنتوج المحلي. إذ تعتبر وفرة وانتظام هذه المنتوجات الرهان الأساسي للدولة فيما يخص الأمن الغذائي، حيث يجب على الدولة تلبية الحاجيات الغذائية للمدن خاصة منها تلك التي تشهد نموا ديموغرافيا متزايدا. سهل زيبان يقع بمحاذاة مدينة بيسكرة التي تعرف دينامية فلاحية قوية، إذ يتواجد على أبواب الصحراء مما يجعله يتسم بشاسعة مساحته المزروعة، كما أنه يتسم بمناخ جاف و ينعم بمنابع كثيرة للماء. دراستنا هذه ترتكز أساسا على مسارات العديد من الشباب الجزائريين الذين يتوافدون على هذا السهل ليبحثوا عن فرصة للشغل، تحديدا عن طريق زراعة الخضروات تحت البيوت البلاستيكية. حيث يبدؤون كأجراء أو كعمال يتقاضون أجورهم بنسبة من المحصول الزراعي ثم إلى مستأجرين، حيث يستطيعون في وقت وجيز أن يصبحون شركاء، مكترون، ثم ملاك. إن مشروعهم غالبا ما يكون إما استثمار متوسط المدى في النشاط الفلاحي على المستوى المحلي أو على صعيد الجهة التي ينحدرون منها، وإما بمغادرتهم كليا للنشاط الفلاحي. بحثنا هذا سيرتكز على السياسات العمومية التي تقوم بها الدولة لإدماج هؤلاء الفاعلين الجدد في مهنة الفلاحة.